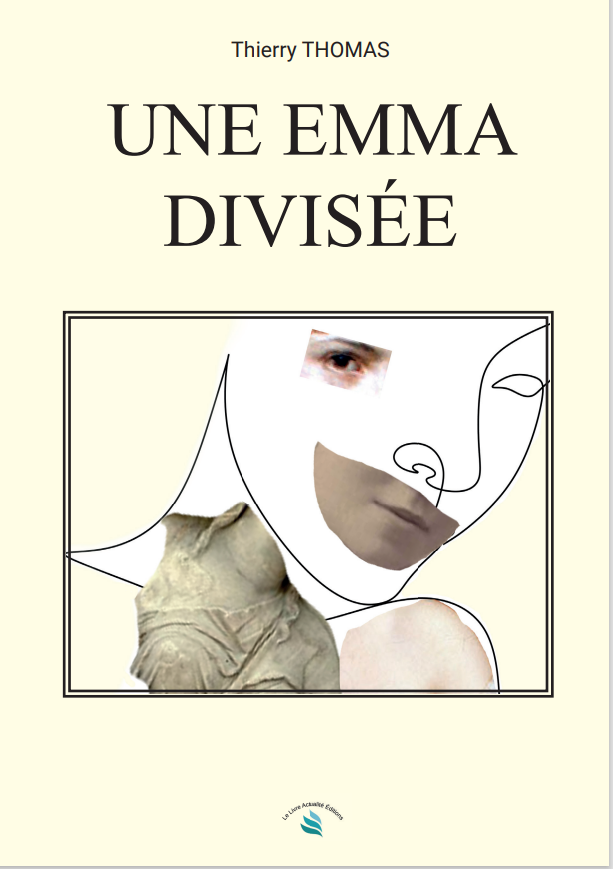Non, ce n’est pas une contrepèterie. C’est une réalité observable.
On n’a jamais autant travaillé, ni autant valorisé la valeur travail (étymologie, pour rappel: vient de tripalium: instrument de torture).
9 jours chômés par an (à peu près), contre 80 au Moyen-Âge.
-Ouais, mais à l’époque, ils crevaient de faim, ils avaient la peste, ils mouraient à 30 ans et ils avaient la guerre…
Pas exactement…
A l’époque, évidemment, on mourait jeune, mais pas parce qu’on ne travaillait pas beaucoup: uniquement parce que la médecine et l’hygiène n’étaient pas encore à un stade très poussé. Oui, il arrivait qu’il y ait la guerre, mais pas plus de 40 jours par an, puisque les seigneurs ne pouvaient pas mobiliser leurs troupes plus qu’une « quarantaine ».
Oui, il y avait des famines, mais ce n’était pas faute de travail, c’était dû aux mauvaises saisons.
Oui, on mourait jeune, de la grippe ou d’une apendicite, pas à cause du manque de travail, mais parce que les chirurgiens et les antibiotiques n’existaient pas.
Et, non, ils n’avaient pas la peste: elle n’arrive qu’au XIVe Siècle. La peste est plus une spécialité des Temps Modernes.
Bon. Ceci réglé, pourquoi les gens travaillaient peu à l’époque? Parce qu’il n’y avait pas grand’chose à consommer, donc pas grand’chose à acheter.
-Ouais, les gens s’emmerdaient à cette époque.
Pas du tout. S’emmerder, au Moyen-Âge?
Ah certes, ils n’avaient pas notre niveau culturel: la télé-réalité et l’Eurovision de la chanson n’existaient pas encore; Marc Lévy et Gilles Musso n’étaient pas nés; la Coupe du Monde de Football et le coca-cola ne faisaient pas partie du décor. Mais on ne s’emmerdait pas pour autant: les flambées, les fêtes de village (80 jours par an!), le carnaval, les histoires des anciens qui transmettaient les valeurs, les mariages, les baptêmes, les enterrements: tout le monde participait à tout.
Sans compter qu’il y avait les relations sociales, notamment avec les seigneurs, le conseil des anciens, le chef du village (éventuellement); et puis les petites bisbilles au sein du village, la rebouteuse, le plus riche qui faisait des envieux, etc. Non, il y avait de la baston parfois aussi, et puis la fameuse « Quarantaine », qui pouvait réquisitionner quelques villageois en été, lesquels accompagnaient le seigneur pour une virée dans les terres du seigneur voisin, ce qui permettait, au retour, de belles histoires…
On ne s’emmerdait pas, mais on mourait de trucs bêtes. Donc, il n’y a pas à regretter le Moyen-Âge, évidemment: j’y serais sans doute mort très jeune, vu toutes les maladies infantiles que je me suis choppées. Mais que cela ne nous empêche pas de réfléchir à une chose: pourquoi valorisaient-ils leurs vies alors qu’ils mouraient jeunes, qu’ils ne pouvaient pas consommer?
Ben justement: eux valorisaient leurs vies, précisément parce qu’ils mouraient jeunes et ne pouvaient pas consommer: ils étaient et ils faisaient; ils n’avaient pas besoin d’avoir (d’ailleurs, ils ne pouvaient pas avoir), et donc leurs vies passaient par l’être et le faire.
Le temps était plus réduit? Oui, mais ils travaillaient moins. Au total, proportionnellement, ils avaient bien plus de loisirs que nous.
Ils n’en profitaient pas? Au contraire! Certes, ils ne partaient pas à Ibiza ou à Torremolinos, mais ils pouvaient se fendre la gueule (aux dents pourries, sauf qu’ils avaient peu de carries, puisqu’ils ne mangeaient pas de sucre) dans les fêtes locales. Evidemment, aujourd’hui, nous ne pourrions pas nous contenter de cela… Nous préférons nous gorger de clowneries sans nom à la télé et sur internet… Nous jouons à Clash of Clans et à Candy Crush… Nous votons pour exclure des clowns dans des émissions dénuées d’autres sens que de la valorisation de la compétition… Nous nous extasions devant les victoires de 11 gugusses surpayés qui se fichent de la misère sociale de leurs cousins… Nous pleurons cinq minutes devant les victimes des tremblements de terre et du Tsunami, mais nous préférons rigoler devant le bêtisier de fin d’année… Nous aimons Astérix, mais en aucune manière nous n’accepterions de valoriser sa façon de vivre (rigoler avec les copains et se contenter, en guise de travail, d’aller chasser un sanglier de temps en temps)…
Si nous avions la même attitude par rapport au travail qu’eux, avec les progrès scientifiques dont nous bénéficions, nous pourrions tous avoir le niveau intellectuel de Prix Nobel de physique ou de littérature.
Nous ne valorisons pas la vie, alors que nous avons la chance de pouvoir le faire infiniment plus que les gens du Moyen-Âge; il nous suffirait de concentrer notre énergie sur la valorisation de la médecine, de la recherche dans les économies d’énergie et dans les soins de santé, et nous pourrions offrir des cent ou cent cinquante jours de congé à tout le monde (y compris les médecins et les chercheurs), en partageant le travail de manière intelligente.
Nous ne valorisons pas la vie, nous valorisons le travail, qui ne devrait être qu’un moyen de jouir de la vie.
Nous valorisons le travail qui est une torture.
Nous héroïsons les stakhanovistes, alors que nous vomissons le système soviétique.
Nous vomissons le système soviétique, alors que nous promouvons (au moins dans l’idéologie) l’égalité des chances, qui est une illusion imbécile produite par les fabricants de jouets en plastique et leurs associés des entreprises pharmaceutiques, des producteurs de gadgets électroniques et des vendeurs d’armes. Donc, nous préférons une illusion imbécile à l’idée même de l’égalité des hommes et des femmes (Je ne dis pas que les Soviétiques étaient arrivés à cet idéal, mais notre société n’est pas meilleure: nous sacrifions tous les jours des milliers d’hommes et de femmes sur l’autel de la consommation: les accidents du travail, les accidents de la route, les dépressions, les burn-out, les licenciements, les suicides sur le lieu d’activité, etc. et ceci sans compter évidemment les « ateliers du monde » dans les pays en voie de développement).
Nous encensons les héros de la bourse et les banquiers-philanthropes, les vitrines politiques et les propriétaires de journaux, bien que nous fassions de temps en temps semblant de les vouer aux gémonies, le temps d’un scandale, puis nous retournons voter pour les mêmes, qui sont leurs amis, leurs alliés, qui les installent aux postes clés de décision, qui nous enfument de leurs nécessités: l’emploi, la croissance, la compétitivité.
Nous sommes des veaux (le général n’avait pas tort).
Nous sommes des imbéciles, parce que même lorsque nous aspirons à quelque chose de différent, nous ne voulons surtout pas que cela change.
Nous sommes des pleutres, parce que nous craignons le changement alors que nous ne sommes pas satisfaits de notre sort.
Nous sommes des êtres pensants qui savons que nous allons mourir et qui passons notre vie à éviter d’y penser en nous abrutissant dans des fonctions dénuées de sens.
Nous sommes des Stakhanovs: nous courons après des médailles en chocolat, mais le pire c’est que ce n’est pas idéal, mais pour continuer d’alimenter la course à la production, à la consommation, à l’abrutissement des masses.
Au moins, Stakhanov avait le souci de se faire valoriser pour un idéal plus grand que lui. Je ne dis pas qu’il avait raison, mais ça a plus de gueule que le souci de complaire aux publicitaires et à leurs capacités à nous faire avaler tous les six mois un nouveau gadget qui contribue à la mise à sac des ressources naturelles de la Terre. Nous sommes des Stakhanovs qui avons oublié pourquoi nous travaillons. A part peut-être pour le loto… Nous sommes des lotophages…
Pourquoi ne prendrions-nous pas le meilleur du Moyen-Âge pour l’associer à ce qu’il y a de meilleur aujourd’hui?
Pourquoi ne chercherions-nous pas à suivre les principes de Lafargue et de Lagaffe plutôt que ceux d’Attali et de Soros?
Nous pourrions nous contenter de travailler deux ou trois jours par semaine en moyenne, et nous serions encore capables d’aller rendre visite à nos proches de l’autre côté de la Terre sans problème. La productivité des activités essentielles, et même des activités secondaires, permettraient à tous les hommes de vivre bien, longtemps (sauf accident), de profiter de leurs loisirs, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de découvrir les autres et surtout de vivre en phase avec la nature, plutôt que de se tuer dans des activités hors-saison, de nuit, de garde…
Nous pourrions imaginer de vivre différemment et de ne rien regretter au moment de notre mort…
Nous pourrions réduire aussi notre pouvoir de nuisance, en concentrant notre consommation sur ce qui est vraiment nécessaire, en sélectionnant des systèmes moins polluants, moins contraignants, moins salissants, et surtout qui ne nécessiteraient pas que notre Occident aient besoin de faire la guerre un peu partout dans le monde, d’exploiter toutes ces régions encore exclues de notre « belle société de consommation ».
A nous de voir…